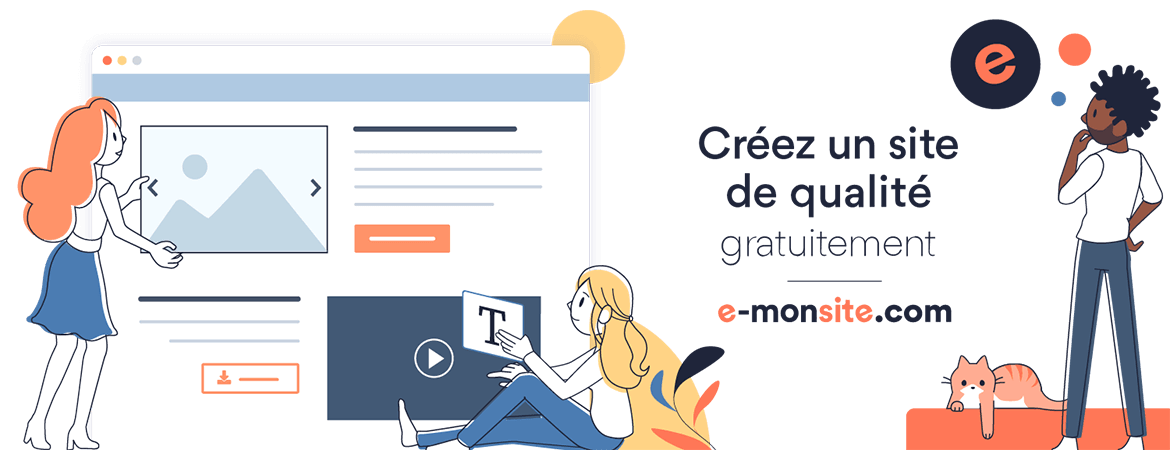Les poèmes de mon père 1ère partie
TOUS LES POÈMES DE MON PÈRE ÉCRITS ENTRE 1917 ET 1970, RECONSTITUÉS DE MÉMOIRE, POUR LA PLUPART, APRÈS LA PERTE DE SON RECUEIL DANS LES BOMBARDEMENTS DE LA GUERRE 1939-1945
Le passé revient sans cesse
Sous notre œil émerveillé ;
Le bruit de quelque caresse,
Monte d’un arbre effeuillé.
On complote sur la terre,
On complote dans les airs ;
On fait suivre le mystère
Dans ces petits faits divers.
Il est dangereux de plaire
Parmi le monde où l’on vit,
Et le mieux est de se taire
Que d’écouter ce qu’on dit.
Portons notre âme discrète
Dans le vert rayonnement
Des bois dont on voit la tête
Noircir le bleu firmament.
Notre féconde paresse
A la perspicacité
D’un homme qui, dans l’ivresse,
Cherche sa lucidité.
Est un peu fou qui compose
Dans la prose ou dans les vers :
Le génie est une chose
Qu’on regarde de travers.
On naît, pour être poète,
La besace sur le dos ;
On vous prend pour la comète,
Et charge de tous les mots.
Si l’on a joli visage,
Une fillette, en marchant,
Se tourne à votre passage,
Vous dit « Oh ! qu’il est charmant ».
On a la crainte sauvage,
La pusillanimité
D’un oiseau, vivant en cage,
Qui cherche la liberté.
On accuse la planète
De tourner trop vite ou pas,
Alors que c’est notre tête,
Elle, qui marque le pas.
Voulez-vous que je vous dise
La complète vérité ?
On attelle la bêtise
Au char de l’hilarité.
Philosophe, songe et passe,
Les rêves sont nos amis,
Auxquels nous faisons la chasse,
Et capturons sans permis.
L’arbre est un songeur morose,
Droit devant l’éternité,
Un lutteur qui se repose
En toute sérénité.
Il abrita la tendresse
Des amants, venus le soir,
A l’heure où le soleil baisse
Son gigantesque miroir.
Il est l’âme du bocage,
De la forêt, la splendeur
Où l’oiseau prend son ramage,
Et le lis blanc sa candeur.
De l’amour il est l’emblème,
Le souvenir le plus cher
Quand on marque, dans sa chair,
Le nom de celle qu’on aime.
Le 10 septembre 1944.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
DES « DERNIERS JOURS DE POMPEI »
DE BULWER LYTTON
Dans un triclinium , près de la belle Ionne,
Soupire, cher Glaucus, dans les parfums flottants,
Pendant que Claudius de pampre se couronne,
Ranime par le vin ses membres languissants.
Pendant que d’Abarcès, l’ombre errante et mortelle,
Parcourt cet antre obscur qu’habite le chacal,
Et que de la saga, la figure éternelle,
Bannit d’elle le bien et rappelle le mal.
Fervent prêtre d’Isis, as-tu fait ta prière ?
Nydia, belle Nydia, viens, accours dans mes bras,
Dessille tes beaux yeux, privés de la lumière,
Désormais tes regards pourront suivre mes pas.
Oh ! ne jalouse pas, Nydia, la douce Ionne,
Ta maîtresse, ta sœur, ta rivale en amour,
Laisse fuir ce chagrin auquel tu t’abandonnes,
Qui renaît dans ton cœur comme apparaît le jour.
Va cueillir dans les champs, va cueillir sur les rives,
Les roses de Paestum, chères aux vieux Romains,
Dont les bouquets flottants, sur les eaux fugitives,
Portaient leurs doux parfums aux rivages lointains.
Nydia, tresse des fleurs, et que ma bien aimée,
Belle comme le jour, de rose parfumée,
Se recueille en mes bras et se livre à l’amour,
L’amour n’a pas de nom pour qui l’aime avec charmes,
L’amour ! et ce seul mot qui m’étanche les larmes,
N’est-il fait que pour vivre un jour !
Non, il vivra jamais, et mon âme fidèle,
Le symbolisera dans sa vie éternelle ;
C’est le plus pur lien qui réunit les coeurs,
C’est le plus pur lien de la sœur et du frère,
De l’amante et l’amant que l’amitié sincère
Unit même dans les douleurs.
Au temple de Vénus mon amante m’appelle,
Et sa voix se répète à celui de Cybèle,
Je cours, je vole et vais apaiser ses clameurs.
O dieux qui, de l’Olympe, écoutez ma prière :
Que son front, à jamais, jusqu'à l’heure dernière,
Pose sur mon sein nu, comme sur une pierre
Une mère, à genoux, vient répandre des pleurs.
Des pleurs ! non, point de pleurs, soyez joyeux convives,
N’exhalez dans les airs vos plaintes fugitives,
Célébrez vos vertus par des libations ;
Que le vin, à jamais, circule dans vos veines :
Amis, préparez-vous à des courses lointaines,
A vaincre un autre peuple et d’autres nations.
Sur ce sol de héros, vit-on plus de courage
Que ces nobles vieillards, vénérés pour leur âge ?
Ils sont fiers et vaillants, pleins d’espoir pour demain ;
La liberté leur est plus chère que la vie,
Et quand vous prononcez ce seul mot de : Patrie,
Ils exhibent leurs bras, leur poitrine d’airain.
Ecrit vers 1930.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Non, je ne pensais pas que tu pusses, un beau jour,
Quand les premiers frimas auraient blanchi la terre,
M’envoyer de si loin, tribut de ton amour,
Ton image chérie, adorable étrangère !
Le soir, quand le soleil s’enfonce dans les mers,
Venant comme autrefois sur la grève écumante,
Ecouter du zéphyr les murmures divers,
J’évoque du passé la scène encor vivante.
Ah ! si jamais de moi tu veux te souvenir,
N’attends point mon portrait, créature adorée :
Tes humides baisers, pressés de le ternir,
Effaceraient mes traits sous ta lèvre altérée.
Ecrit vers 1922.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Et lorsque j’arrivai sur le bord de l’abîme,
Parmi les oliviers qui dominaient la mer,
J’entendis une voix monter pure et sublime,
Et se perdre dans l’air.
Je me penchai, ravi, pour mieux entendre encore,
Vers l’être qui pouvait m’envoyer cette voix,
Comme vers le matin on écoute à l’aurore
Des échos dans les bois.
C’était une humble enfant, de haillons recouverte,
Portant dans ses cheveux, pour parer ses quinze ans,
Quelques bouquets d’oeillets, dans une feuille verte,
Cueillis au bord des champs.
Elle avait pour tout bien et pour toute fortune
Un agneau caressant, dans ses bras enlacé,
La suivant pas à pas, le soir au clair de lune,
Quand elle avait passé.
Son chien noir aboyait au seuil de la chaumière ;
Tout en me regardant il clignait la paupière.
Enfin je descendis le sentier jusqu’en bas,
Entre des grenadiers dont la verte parure
Donnait à la maison un air d’architecture
Qu’élève le printemps, sans règle et sans compas.
Tous les jours sont pareils pour cette enfant sauvage :
Sait-elle seulement son nom avec son âge ?
Elle compte ses ans tous les printemps nouveaux,
Elle connaît les fleurs, les arbres, le ciel même,
Des flots la sombre voix dont l’orgueilleux blasphème
Se perd en sifflements dans les frêles roseaux.
Sous l’étoffe grossière un sein rond se dessine,
Son corsage le tient ferme sur sa poitrine :
Connaît-elle son charme et sa rare beauté ?
Elle a miré son front dans l’eau de la fontaine,
Piqué des diamants, dans ses cheveux d’ébène,
Avec l’argent des fleurs qui poussent en été.
Elle ne connaît pas les pièges de la vie :
L’orgueil, la médisance et l’insigne folie
Qu’adoptent les humains pour vivre et puis mourir ;
Elle marche, le front levé vers les étoiles,
Sur l’écume des flots regarde quelques voiles
S’en aller dans la nuit, pour ne plus revenir.
A-t-elle accompagné, ce soir, jusqu'à la plage,
L’amant inavoué que rappelle son cœur ?
Ses yeux ne se sont pas détachés du rivage ;
Dans les airs elle entend un sublime langage
Qui captive ses sens et subjugue son cœur.
S’est-elle demandée, à l’heure du silence,
A l’heure quand la nuit répand son voile noir,
Si son front revêtu d’un nimbe d’innocence,
N’est pas le sceau puissant dont se pare l’enfance,
Pour nous faire languir, crier de désespoir ?
Tout est beau, tout est grand dans cette solitude,
Tout semble respirer cette mansuétude
Du labeur quotidien qu’apporte à la maison
Les bras jamais lassés des enfants et du père :
Les hommes sont pécheurs et la fille est bergère,
Les brebis, pour tribut, apportent leur toison.
Le temps, dispensateur de la vie et des choses,
N’aura pas épargné, sur l’arbuste, les roses ;
Les enfants se seront dispersés par ailleurs,
Et les parents, couchés sous la ronce et le lierre,
Auront pour monument, sur leur tombe, une pierre
Où viendront se poser les vieux merles railleurs.
En résumé, voici ce que c’est que la vie :
Un printemps, une fleur et le besoin d’aimer,
Un rayon de soleil sur notre âme ravie,
Sur notre front pensif quelques gouttes de pluie,
Une tombe de plus qui vient de se fermer !
Ecrit à Marseille, le 21 décembre 1946.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Avant de t’en aller, donne-moi quelques larmes,
Je ne puis concevoir ton départ sans adieu :
Me priver tout à coup du plaisir de tes charmes
Serait tromper le ciel, faire une offense à Dieu.
Mais de notre passé te souvient-il encore ?
Pourquoi pars-tu si loin pour ne plus revenir ?
Que pourront les cieux, que me dira l’aurore
Quand il ne restera de toi qu’un souvenir ?
Alors dans les sentiers que nous foulions la veille,
Promenant mes regrets, exhalant mes sanglots,
Je sens revivre en moi cette ardeur qui sommeille,
Me poursuit nuit et jour sans trêve ni repos.
Tout me rappelle toi, créature adorée :
La mer, les flots, les cieux et l’amandier en fleurs,
Et cette roche plate à la forme carrée
où ma maison recueillit les gouttes de tes pleurs.
Ces pins, ces oliviers, cette flore abondante,
Ces plaintes, dans les airs, et ce soleil couchant,
Ces baisers échangés quand tu fus mon amante,
Cette voix dont l’écho m’en renvoyait le chant.
Cette tristesse, enfin, dont je vivais naguère,
Croissait avec le temps et me rongeait le cœur,
A mon affliction n’était pas étrangère :
Plus je la combattais, moins j’en étais vainqueur.
Ah ! vous vous accrochiez à cette forme humaine
Vestiges du passé, qui tremble devant vous,
Et me rendez encor cette marche incertaine,
Au lieu de me frayer un chemin calme et doux !
Plus tard, en me voyant, vous me plaindrez peut-être,
Un bâton à la main pour appuyer mes ans,
Et vous murmurer, croyant me reconnaître :
« C’est lui, c’est un vieillard couvert de cheveux blancs.
Quand un siècle s’éteint un autre recommence ;
Les générations n’ont pas deux avenirs :
Chacune, sous le ciel, poursuit son existence,
Et lègue, en s’en allant, un flot de souvenirs.
Ecrit à Marseille, en 1946.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Oui, le jour ruisselle encore
Sur ces rochers battus par les flots écumants,
Que refoule, à chaque aurore,
Comme un fier ennemi, l’haleine des autans.
J’ai vu parfois, sur le rivage,
L’onde jouer avec l’enfant,
Ainsi qu’avec votre visage
Plongé dans son cristal charmant.
Nouvelle néréide, à ses plaisirs, ravie,
Qui semble, dans ses chants, abandonner sa vie,
Comme un cygne mourant, attend avec espoir
Cette heure, heure d’amour et de bonheur suprême,
Qui doit le ramener auprès de ce qu’il aime,
Et que le sort cruel l’empêche de revoir.
Non, non, vous reverrez les lieux de votre enfance,
Ces lieux, chers souvenirs d’amour et d’espérance,
Ces lieux qui furent jadis
Le berceau de votre jeunesse,
Où se sont écoulés des jours remplis d’ivresse
Et transformés, pour vous, en second paradis.
Mais si, loin de ces flots, le bonheur vous inonde,
Que votre souvenir jamais ne me confonde
Avec les ombres de la nuit :
C’est assez d’espérer et de voir, à tout heure,
Ses parents adorés, au seuil de leur demeure,
De vivre loin du monde, ainsi que de tout bruit.
Moi, que votre départ tourmente sans cesse,
Devrai-je donc me plaindre et pouvoir soupirer ?
Moi, qui suis chaque jour plongé dans la tristesse,
C’est assez de gémir, il me faudra pleurer.
Ecrit vers 1917.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Une vieille maison était au bord de l’eau.
L’homme l’avait refaite et crépie au cordeau.
La femme, jeune encor, aux cheveux noir d’ébène,
A genoux, blanchissait, dans l’eau d’une fontaine,
Le linge des enfants, sous les grenadiers verts.
Ils étaient trois : deux fils au sourire pervers,
Une fille : à treize ans, que disait son sourire ?
Elle baissa les yeux, lorsque j’allais lui dire :
« Bonjour, divine enfant, cet éden est pour vous,
Le ciel, le paradis, le séjour le plus doux.
Violette des bois, anémone, pervenche,
Vous êtes le parfum sur lequel on se penche,
Vous êtes un rayon de soleil descendu
Sur mon rêve éternel, si longtemps attendu.
Muette, simulant la pudeur de son âge,
Elle cache ses seins derrière son corsage ;
Elle voulut tirer, au-dessous des genoux,
Un pan de son jupon tout constellé de trous.
Se faisant plus petite, elle voulait, sans doute,
Aller par les sentiers et déserter la route,
Mais mon regard la tint craintive devant moi :
Je la voyais bergère, elle me croyait roi.
Seule dans ce désert, c’était le même monde
Qu’elle cherchait dans l’air, qu’elle entendait sur l’onde,
Sa famille était tout ce que peut désirer
Un cœur jeune et naïf qui ne sait qu’admirer.
Enfin, s’enhardissant : « Bonjour monsieur ! », dit-elle,
Et je lui répondis : « Bonjour, mademoiselle.
Un éclair traversa son œil profond et noir ;
J’y compris des secrets qu’elle me laissa voir.
Les fleurs de grenadier, dont son front s’auréole,
Pleuvaient sur les cheveux de la belle espagnole.
« A demain ! » me dit-elle. O ciel, depuis ce jour,
Je connais le bonheur dans les bras de l’amour.
Marseille, le 23 novembre 1940.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Demandez, au cœur romantique,
D’où lui vient l’inspiration ;
D’où lui vient ce chant magnifique
Né dans la méditation.
Je suis provençal d’origine :
Ma mère parlait provençal ;
Aussi mon père, j’imagine,
S’il eût vécu, bonté divine,
Eût fait honneur au grand Mistral.
Ma mère portait la coiffure
D’arlésienne en son pays ;
Elle était de grande stature,
Jolie et belle de figure
Autant que Dieu l’avait permis.
Elle avait la voix douce et forte,
Le cœur bon, le rire ingénu :
Toujours quelqu’un, devant sa porte,
S’arrêtait pour parler, en sorte
Qu’il était tard, le soir venu.
Ce souffle inspirateur dont la nature entière
Eût fécondé son sein, elle me l’a donné,
Elle me l’a transmis, ainsi que la lumière,
Qu’elle reçut du ciel, dans sa source première,
Elle me l’insuffla lorsque son fils est né.
Évocateur du temps, de sa douce influence,
Parmi les souvenirs que découvrent mes yeux,
Je viens porter mes pas aux lieux de mon enfance,
Leur demander asile, un coin silencieux.
Ah ! je ne savais pas que dans le cimetière,
Le repos éternel leur était consacré,
Mes chers amis d’hier avaient clos leur paupière,
Leur image m’était comme un dépôt sacré !
Quand mon genou sentit le froid nu de la tombe,
Tout mon être frémit du frisson de la mort ;
Une voix s’éleva, celle de la colombe,
D’entre les cyprès noirs contre le mur du nord.
En vain, j’avais prié pour une âme inconnue,
Que je cherchais dans l’air ; sur terre et dans les cieux,
Sur les chemins déserts dispersés dans la nue,
Quand l’ombre du trépas se formait sous mes yeux.
La mort vient de la prendre en la force de l’âge ;
Sa tombe se creusait muette devant moi.
Je n’aurais cru jamais avoir tant de courage,
Conservé la raison et douté de la foi.
Le cygne, dans l’étang, jeta son cri nocturne,
Vers le bord opposé dirigea son essor ;
A compter de ce jour, sur mon front taciturne,
Resta gravé ce mot, qu’on peut y lire encor :
« Ma mère ! souvenir de tristesse et de charme,
Que le génie humain ne me rendra jamais ».
Pour consolation, il me reste une larme
Que je donne, en priant, à l’éternelle paix.
Ecrit à Marseille, le 26 novembre 1945.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Le soleil, à mes yeux, n’avait plus sa beauté,
N’était plus, à mes sens, que sphère de clarté :
Les champs, les fleurs, les fruits revêtus de leurs charmes,
Recevaient, de mes yeux, l’aumône de leurs larmes.
L’insensibilité de mon cœur appauvri
Rejetait, loin de moi, ce qui l’eût attendri
Au temps, à l’heureux temps où les fleurs sur ma tête
Laissaient pleuvoir leur neige au vent de la tempête ;
L’amandier centenaire, au penchant des coteaux,
Debout comme un géant défiant le cahot,
Tordait ses bras nerveux, enfant de Briarée,
Dont les gémissements remplissaient la contrée.
Les hommes ont changé d’âge, mais leur séjour
N’est-il ce qu’il avait été jusqu'à ce jour ?
Sans attendrissement, peuvent-ils, ô nature,
Aimer ce qui gémit, chante, pleure et murmure ?
Exhumer du passé, de cendre recouvert,
Quelque grand souvenir devant nous entr’ouvert ?
Sous l’herbe de nos pas une chose demeure :
La voix de l’outre-tombe, arrivée à son heure.
Fuyez...fuyez... mais non, je veux m’entretenir :
Ma jeunesse n’a plus que vous pour souvenir.
Et si le roc blanchi, sous la vague amoureuse,
Si le pin vigilant, et la modeste yeuse,
Ont été par la main de l’homme anéantis,
Je demeure rêveur, mais nullement surpris.
Istres, mon beau pays, les malheurs de la guerre
Ont ravagé tes champs, bouleversé la terre,
La terre de l’olive et du blanc romarin
De mes aïeux chéris, couchés près du chemin ;
Terre de souvenirs, de plaisirs et de larmes,
Tu conserves encor, à mes yeux, tous tes charmes.
Qu’est devenu mon chien, fidèle serviteur ?
La faux du temps l’a pris malgré son protecteur ;
Où sont mes pigeons blancs, mes oiseaux de volière ?
Mes fleurs dans le jardin, ou sur un tas de pierre ?
Sans les secours du ciel, que seraient devenus
Ces éléments épars que nous avons connus ?
Le ciel ! ah, dira-t-on, mais le ciel est immense :
Il n’a jamais de fin, toujours il recommence,
Et son éternité prouve que nous tournons
Tous dans le même sens et puis recommençons :
Les saisons et les mois nous sont une habitude
De le considérer dans leur vicissitude.
Qui n’a, dans son destin, affronté les frimas,
Et sur le sol glacé posé ses premiers pas !
J’ai mangé mon pain blanc au foyer de ma mère ;
Il est noir, aujourd’hui, de couleur de la guerre ;
Notre maison n’est plus, tout n’est qu’un souvenir,
Tout est enseveli pour ne plus revenir,
Tout ce que nous aimions, voyions à tout heure,
A rejoint le néant avec notre demeure.
Le ciel a préservé ma femme et mon enfant,
Retirés sains et saufs de cet enfer brûlant :
Les tombes avaient fait, et pris cette mesure,
Ce que, pour les mortels, n’eût osé la nature.
Marseille, Janvier 1942.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
O Fabre, il n’est pas d’églantine
Qui ne veuille trop admirer,
Se penchant sur son étamine,
Le savant prêt à retirer,
Endormi dans quelque calice
De fleur, l’insecte convoité,
Croyant, par ce seul artifice,
Tromper l’œil expérimenté
De notre homme dont le génie
Fixe les sens, guide les pas ;
Pour qui la nature infinie
N’est plus un mystère ici-bas.
Il faut l’œil de l’expérience,
La raisonnement du savant,
La volonté, la confiance,
L’obstination de l’enfant,
Observer, confondre, déduire,
Comparer puis tout démolir,
Édifier et reconstruire,
Nourrir, tuer, ensevelir,
Tout un monde, à vie éphémère,
De ces infiniment petits,
Surgis tout à coup de la terre,
Que reprennent ses appétits.
Il faut être, de quelque étoile,
Marqué par le rayon divin,
Que nulle passion ne voile
Pour continuer son destin.
Que cherche-t-il, sur cette route
Où les ronces mordent sa main ?
Où s’est réfugié le doute
Qu’il combat et tue en chemin ?
La vérité ! Pour qu’elle sorte,
Il faut lutter, il faut souffrir,
Et, même quand on la croit morte,
Homme, l’empêcher de mourir.
Nous devons un pieux hommage
Aux chercheurs qui nous font savoir,
Connaître le muet langage
Que leur science nous fait voir.
Ils sont simples de caractère,
Timides, gauches quelquefois ;
Ont toujours un calcul à faire
Dont ils supportent mal le poids.
Rentrés chez eux, ils sont à l’aise,
Peuvent se livrer au travail,
Admettre, soigner l’hypothèse
Comme le sultan son sérail.
Marseille, le 21 février 1949.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
LE MONDE DES OISEAUX
Je voudrais rendre presque humaine
L’histoire de certains oiseaux,
Qu’ils soient des monts ou de la plaine,
Ou fréquentent le bord des eaux.
En avril, tout ce petit monde
Vocalise dans les buissons,
Pour que la famille se fonde
Avec de nouvelles chansons.
La fauvette vient, la première,
Explorer le bas du jardin,
Etablir son nid dans le lierre,
Que décore un pied de jasmin.
Le rossignol, plus fier sans doute
De son talent et de son nom,
Sachant que le monde l’écoute,
Le pose près de la maison.
Le minuscule troglodyte,
Ramassé comme une souris,
A travers le bois prend la fuite
Quand notre regard l’a surpris.
La mésange charbonnière
Sonde le trou d’un peuplier,
En entre et sort à la manière
D’un voleur en train de piller.
Le merle, ce seigneur superbe,
nspecte la propriété ;
Comme en forêt, entre dans l’herbe
Manger jusqu'à satiété.
A travers l’onde qui ruisselle,
L’alcyon mêle les couleurs
Du bel arc-en-ciel de son aile,
Aux teintes de certaines fleurs.
La bergerette, sur la pierre,
Agite sa queue en battoir,
D’où lui vient son nom lavandière,
Oiseau fréquentant le lavoir.
Au printemps, sur l’épine blanche,
Le pinson, hôte des jardins
Dans son bel habit du dimanche,
Entonne ses joyeux refrains.
Mais l’oiseau que tout le monde aime
C’est l’élégant chardonneret,
Coiffé de son noir diadème ;
Des couleurs ayant le secret.
Avec le serein, il partage
L’arbre, le massif, le verger,
La source dans le voisinage,
Et l’air libre pour voyager.
L’alouette vit dans la plaine ;
Le loriot aime les bois
Où chante l’eau d’une fontaine,
A laquelle répond sa voix.
Tout ce petit monde partage
L’allégresse du gai printemps :
La nature est la grande cage
Où le bon Dieu les mit dedans.
Ils ne connaissent la rancune,
Ils ne savent pas désirer ;
De vengeance, ils n’en ont aucune,
Quand on les entend soupirer.
Homme, respecte leur couvée
Dans le vieux mur ou le buisson :
Quand sa famille est enlevée,
L’oiseau meurt avec sa chanson.
Fait à Marseille, le 3 mars 1948.
© SDGL - Échos Poétiques 2005
Date de dernière mise à jour : 2019-12-18 19:26:44